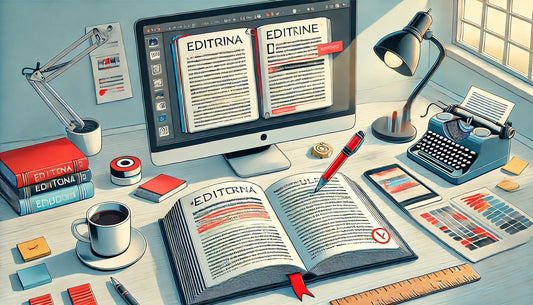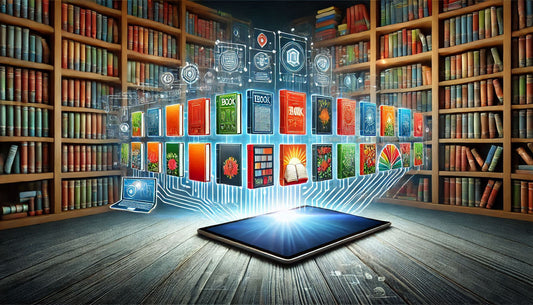Jean-Luc Einaudi, une vie d'engagements : le colloque du 25 octobre 2025 à Paris
L'auditorium de l'Hôtel de Ville de Paris a vibré, le 25 octobre 2025, au rythme d'une journée exceptionnelle. L'association Les Ami.e.s de Jean-Luc Einaudi y organisait un colloque entièrement dédié à cet homme hors du commun : « Jean-Luc Einaudi, une vie d'engagements ». Historiens, militants, avocats et témoins se sont retrouvés pour célébrer l'œuvre d'un chercheur autodidacte qui a consacré son existence à une mission : sortir de l'ombre les pages les plus douloureuses de notre histoire coloniale.
Qui était Jean-Luc Einaudi ?
Il y a des parcours qui échappent aux trajectoires classiques. Jean-Luc Einaudi (1951-2014) était de ceux-là. Éducateur de formation, ancien travailleur de la Protection judiciaire de la jeunesse, il est devenu, presque malgré lui, l'un des plus grands spécialistes de la guerre d'Algérie. Son nom reste indissociable du 17 octobre 1961, ce massacre d'Algériens à Paris dont personne ne voulait parler pendant des décennies.
Ce qui frappe chez Einaudi, c'est cette obstination tranquille, cette manière de fouiller les archives, de recueillir les témoignages, de croiser les sources avec une rigueur d'historien professionnel. Pas de chaire universitaire, pas de laboratoire de recherche : juste un homme face à ses documents, déterminé à faire surgir la vérité.
Son combat a trouvé son apogée en 1999, quand il a affronté Maurice Papon devant les tribunaux. L'ancien préfet de police de Paris l'avait poursuivi en diffamation après ses révélations sur le massacre. Einaudi a gagné. Cette victoire judiciaire a marqué un tournant : pour la première fois, la France reconnaissait officiellement la réalité du 17 octobre 1961.
Une journée riche en découvertes
Le colloque s'est déroulé en trois temps, comme trois facettes d'une même vie extraordinaire.
L'homme derrière l'historien
La première table ronde nous a fait découvrir les racines de l'engagement d'Einaudi. Joëlle et Gilbert Rigal, Alain Castan, sa fille Elsa Einaudi, Marie-Laure Tenaud, Jean-Jacques Yvorel et Patrick Karl ont partagé leurs souvenirs et leurs analyses. On y a compris comment son travail d'éducateur auprès des jeunes nourrissait sa réflexion d'historien. Chez lui, l'action sociale et la recherche historique ne faisaient qu'un : impossible de séparer l'homme de terrain du chercheur plongé dans les archives.
Le pionnier d'une histoire longtemps refusée
La deuxième session a réuni des pointures : Daniel Kupferstein, Emmanuel Blanchard, Nadine Fresco, Fabrice Riceputi, Gilles Manceron, le journaliste Edwy Plenel, Philippe Grand, aux côtés d'Elsa Einaudi et Patrick Karl. Ensemble, ils ont exploré la méthode Einaudi. Car il ne s'agissait pas seulement d'écrire l'histoire du colonialisme : il fallait d'abord la faire accepter, la légitimer face à ceux qui préféraient l'oubli.
Einaudi a ouvert des brèches là où d'autres voyaient des murs. Son approche, fondée sur un travail d'archives obsessionnel et une écoute attentive des témoins, a créé une nouvelle manière de faire de l'histoire. Une histoire au ras du sol, au plus près des victimes.
Le 17 octobre 1961 : quand un homme fait basculer l'histoire
C'était sans doute le moment le plus intense de la journée. La troisième table ronde a plongé au cœur du combat d'Einaudi : le 17 octobre 1961. Arié Alimi, Pierre Mairat, Kahina Ait Mansour, Louise Vignaud, Olivier Le Cour Grandmaison, Cherif Cherfi, Mehdi Lallaoui, Sohir Belabbas, Daniel Kupferstein et Amar Nanouche ont montré comment un seul homme, par son travail acharné, a pu transformer un événement occulté en symbole des violences coloniales.
Rappelons les faits : le 17 octobre 1961, des dizaines d'Algériens sont tués par la police parisienne. Ils manifestaient pacifiquement contre un couvre-feu raciste qui leur était imposé. Pendant près de quarante ans, silence radio. Comme si rien ne s'était passé. Comme si ces morts n'avaient jamais existé.
Jean-Luc Einaudi a refusé ce mensonge par omission. Enquête après enquête, livre après livre, témoignage après témoignage, il a reconstitué la vérité. Et quand Maurice Papon a voulu le faire taire, il a tenu bon. Sa victoire devant les tribunaux a fissuré le mur du silence officiel.
Aujourd'hui, quand on parle du 17 octobre 1961, c'est largement grâce à lui. Les commémorations, les plaques, les reconnaissances officielles : tout cela découle de son obstination.
Pourquoi Einaudi nous parle encore
Ce colloque, ouvert par Fabrice Riceputi et Elsa Einaudi, n'était pas un simple hommage nostalgique. Il a rappelé quelque chose d'essentiel : l'œuvre d'Einaudi reste terriblement actuelle. Les questions mémorielles liées à notre passé colonial continuent d'agiter la société française. Les débats sur la repentance, la reconnaissance, la transmission de cette histoire douloureuse sont loin d'être clos.
Einaudi nous a légué plus que des livres. Il nous a transmis une exigence morale : celle de regarder notre histoire en face, même quand elle nous dérange. Il nous a montré qu'on ne peut pas construire une société apaisée sur des mensonges et des oublis organisés.
L'histoire, nous dit son parcours, n'est pas réservée aux professeurs d'université. Elle appartient aussi aux citoyens qui refusent l'amnésie collective. À ceux qui, armés de leur seule détermination, font le choix de la vérité contre la facilité du silence.
Les interventions de cette journée prouvent que l'héritage d'Einaudi est vivant. Les chercheurs, les enseignants, les militants, les citoyens continuent son travail. Ils défrichent d'autres zones d'ombre, ils interrogent d'autres silences. C'est la meilleure façon de lui rendre hommage.
Découvrir Jean-Luc Einaudi
Si vous voulez plonger dans son œuvre, l'association Les Ami.e.s de Jean-Luc Einaudi a rassemblé une mine de ressources : sa biographie complète, ses ouvrages majeurs sur la guerre d'Algérie et le 17 octobre 1961, des archives, des témoignages. Tout est là pour comprendre comment cet éducateur discret est devenu une figure incontournable de l'histoire contemporaine.
Parce qu'au fond, Jean-Luc Einaudi nous rappelle une chose simple : l'histoire n'est jamais vraiment finie. Elle se réécrit, se complète, se corrige au fil du temps et des combats. Et tant qu'il y aura des chercheurs de vérité comme lui, les pages obscures de notre passé finiront toujours par s'éclairer.
Une œuvre accessible à tous
Il y a plus de dix ans, la maison d'édition Digital Index a eu le privilège de publier l'une des œuvres majeures de Jean-Luc Einaudi : Franc-tireur - Georges Mattéi de la guerre d'Algérie à la guérilla.
Cette édition numérique augmentée, désormais dans le domaine public, est bien plus qu'une simple publication. Elle a été enrichie de nombreux documents inédits, de photographies rares, d'interviews exclusives et de vidéos d'archives qui donnent une profondeur exceptionnelle au récit. Parmi ces trésors documentaires : le manuscrit de Georges Mattéi sur sa rencontre avec Jean-Paul Sartre, des textes publiés dans Les Temps modernes et Esprit, une pièce de théâtre inédite, ainsi que des entretiens réalisés par Einaudi avec des figures comme Gérard Chaliand, François Maspero ou Adolfo Kaminsky.
Le livre retrace le parcours extraordinaire de Georges Mattéi, tour à tour soldat en Algérie, passeur de frontières, fabricant de faux papiers, journaliste et écrivain. Un homme qui a côtoyé Jean-Paul Sartre, Fidel Castro et Daniel Cohn-Bendit – qu'il fit entrer clandestinement en France en mai 1968.
À travers cette biographie captivante, c'est toute une époque qui ressurgit : celle des combats anticoloniaux, des solidarités internationales, des engagements sans compromis. Une fresque historique qui résonne encore aujourd'hui.
Aujourd'hui dans le domaine public, cet ouvrage demeure un témoignage essentiel pour comprendre l'œuvre et la méthode de Jean-Luc Einaudi.
Voir l'ebook sur Digital Index